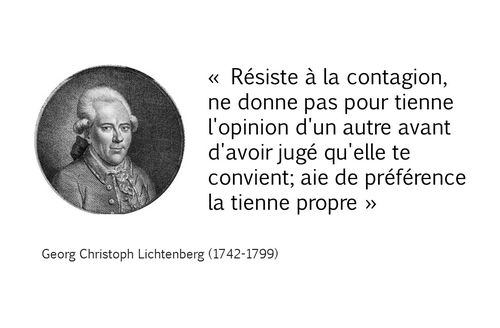Georg Christoph Lichtenberg est un philosophe allemand du XVIIIe siècle dont l’œuvre principale, vue d’aujourd’hui, est la rédaction au quotidien de ses Cahiers sous forme d’aphorismes et de réflexions personnelles, cahiers tenus entre 1764 et 1799, année de sa mort.
Un auteur, par ailleurs sinologue que j’affectionne particulièrement pour sa conception de la traduction, à savoir Jean-François Billeter, publié il y a deux ans aux excellentes éditions Allia une sélection des observations de Lichtenberg, choisies en fonction de son propre intérêt et traduites en français par ses soins (la notice Wikipédia sur Lichtenberg, qui n’était pas à jour sur ce point, l’est maintenant, à la suite de ce billet, merci).
J’en reprends ici quelques-unes dont la lecture et l’actualité m’ont sinon confortée dans mon analyse de la société de l’information, du moins convaincue qu’elles méritaient d’être largement partagées. À noter que les références alphanumériques sont celles de l’édition allemande des Cahiers.
Citations:
Résiste à la contagion, ne donne pas pour tienne l’opinion d’un autre avant d’avoir jugé qu’elle te convient; aie de préférence la tienne propre. (D121)
Les gens qui ont beaucoup lu font rarement de grandes découvertes. Je ne dis pas cela pour excuser la paresse, car faire des découvertes exige qu’on l’on observe par soi-même beaucoup de choses. Il faut plus voir soi-même que se laisser dire. Association. (E467)
On prévient aussi le malentendu quand on apprend aux hommes comment penser, et non pas sempiternellement quoi penser. C’est là une sorte d’initiation aux mystères de l’humanité. Celui qui, pensant par lui-même, aboutit à une proposition bizarre s’en détachera tôt ou tard si elle est fausse, mais quand une proposition bizarre est enseignée par un homme respecté, elle peut induire en erreur par milliers ceux qui ne réfléchissent pas. […] (F441)
Chez nos poètes à la mode, on voit si bien comment les mots produisent la pensée. Chez Milton et Shakespeare, c’est toujours la pensée qui donne naissance aux mots. (F496)
Il faut un temps à Rome où on élevait mieux le poisson que les enfants. Nous élevons mieux les chevaux. Il est tout de même étrange que l’écuyer qui présente les chevaux à la cour reçoive une solde de milliers d’écus et que ceux qui lui amènent ses sujets, les maîtres d’école, crèvent de faim. (H133)
Je considère les comptes rendus comme une sorte de maladie infantile qui touche plus ou moins les livres nouveau-nés. On voit que parfois les plus robustes en meurent et que souvent les plus faibles s’en tirent. Certains ne l’attrapent pas du tout. On a souvent essayé de les protéger par les amulettes des préfaces et des dédicaces, et même de les vacciner par des jugements de l’auteur lui-même, mais cela n’est pas toujours suivi d’effet. (J854)
J’ai souvent été blâmé pour des fautes que mon censeur n’avait ni l’énergie ni l’esprit de commettre. (K37)
Quand on considère la nature comme la maîtresse d’école et les pauvres humains comme ses élèves, on est porté à se faire une bien curieuse idée de l’espère humaine. Nous sommes tous assis dans une même salle de classe, nous avons les principes nécessaires pour comprendre le cours et l’assimiler, mais nous préférons écouter le babillage de nos camarades plutôt que l’exposé de la maîtresse. Ou quand l’un de nos voisins note quelque chose, nous copions, nous lui volons ce qu’il a peut-être mal entendu et nous y ajoutons nos propres erreurs d’orthographe et d’opinion. (K70)
Dans beaucoup de sujets d’études, il n’est pas mauvais de réfléchir d’abord dans un léger état d’ébriété, en prenant des notes; puis de tout terminer de sang-froid et en raisonnant posément. Une certaine élévation due au vin favorise les sauts de l’invention et de l’expression; seule la raison tranquille assure l’ordre et la méthode. (K181)
Pour mesurer tout ce qui dans le monde dépend de la présentation, il suffit de voir du café servi dans des verres à vin, ce qui en fait une boisson misérable, ou de la viande découpée à table avec des ciseaux, ou même, ce que j’ai vu une fois, du pain beurré avec un vieux rasoir, quoiqu’il fût tout à fait propre. (L504)
Si on ne se souvenait pas de la jeunesse, on ne sentirait pas l’âge. Le mal vient seulement de ce qu’on n’est plus en état de faire ce qu’on faisait alors. Car le vieillard est assurément un être aussi parfait en son genre que le jeune homme. (L535)